Pour un pays, il est crucial de prioriser le renforcement de la résilience de ses infrastructures critiques afin d’assurer la sécurité et la protection de ses citoyens, de son économie et de sa souveraineté nationale.
Ces dernières années, on a observé une série d’incendies délibérés et répétés touchant de nombreux Guinéens dans leurs exploitations agricoles, sans qu’une enquête réussie puisse identifier les coupables de ces actes criminels.
Ces attaques sur les biens privés commencent à s’élargir depuis mars 2023 sur les infrastructures critiques et vitale de l’État. Ces actes visant à perturber ou détruire des installations essentielles ont un impact dévastateur sur la société et l’économie Guinéenne dans son ensemble.
Outre les centaines d’incendies d’origine humaine qui ont ravagé principalement les domaines agricoles en Basse-Guinée (Kindia, Forécariah, Boké…), quelques infrastructures essentielles de l’État ont également été la cible d’attaques depuis mars 2023 :
1- Le grand marché de Conakry Madina, la nuit du 03 mai 2024
2- Le grand marché de Conakry dabondi, avril 2023
3- La prison civile de coyah, juin 2023
4- La prison centrale de Conakry, novembre 2023
5- Le principal dépôt de carburant à Kaloum, Decembre 2023
6- La centrale thermique de Kaloum, avril 2024
7- Le pylône de Haute Tension à Manéah, mars 2024
8- Le marché central de N’Zérékoré, mars 2024
9- Le principal dépôt de la société électrique nationale EDG, avril 2024
10- Etc.
Ces événements entraînent des répercussions sérieuses et étendues sur le pays, affectant à la fois les aspects socio-économiques et sécuritaires tels que la déstabilisation sociale, le prolongement de la transition, les risques pour la sécurité nationale et les perturbations significatives dans l’économie.
La principale interrogation concerne l’identité ou les motivations des auteurs de ces attaques. S’agit-il de mobiles politiques, d’activités criminelles ou d’une stratégie de diversion ? Seule la justice et le temps permettront d’éclaircir cette question.
Il est essentiel d’identifier les diverses origines des incidents et des attaques ciblant nos infrastructures critiques afin de mettre en œuvre des mesures de sécurité adéquates pour prévenir et protéger contre de tels événements à l’avenir.
Cela débute par l’identification et la reconnaissance des infrastructures essentielles et vitales qui sont cruciales pour le bon fonctionnement de notre État, incluant notamment :
1- Les infrastructures des réseaux (Énergie, Télécommunications, Eau, Transports, Data centres, …)
2- Infrastructure sanitaire (Hôpitaux, centres de soins, laboratoires médicaux, centre d’hospitalisation épidémiologique et de pandémie…)
3- Infrastructure gouvernementale (Banques, systèmes de paiement, les institutions de maintien de l’ordre public, universités et centres de recherches, ports, camps militaire, bâtiments administratifs, centres de commandement et de contrôle, …)
4- Infrastructure alimentaire (entrepôts de stockage, usines et domaines agroalimentaires, les marchés, le réseaux de distribution… )
Ces infrastructures sont la base sur laquelle repose le bon fonctionnement de notre société. En se préparant efficacement aux menaces potentielles, en allouant des ressources aux dispositifs de sécurité appropriés et en établissant des plans d’urgence robustes, notre pays pourra se protéger contre les attaques et les situations de crise qui pourraient menacer sa stabilité et son progrès.
La protection de ces infrastructures critiques est cruciale pour assurer le fonctionnement stable et sûr de notre pays. Ainsi, plusieurs mesures doivent être prises par l’Etat Guinéen pour renforcer la sécurité de nos infrastructures telles que :
1- Identifier et classifier les infrastructures critiques et vitale dans toutes les régions du pays ;
2- Former et sensibiliser toutes les parties prenantes chargées de la gestion de ces infrastructures aux bonnes pratiques de sécurité et aux procédures d’urgence à suivre en cas d’incident ;
3- Mettre en place des systèmes de surveillance et de contrôle continu pour surveiller en permanence les infrastructures critiques et détecter toute anomalie ou activité suspecte ;
4- Adopter une législation et réglementation appropriée pour renforcer la sécurité, garantir l’accès, l’intégrité et la confidentialité des informations sensibles et punir tout incident contre les infrastructures critiques ;
5- Réaliser des évaluations régulières des risques pour identifier les menaces potentielles et les vulnérabilités de chaque infrastructure ;
6- Mettre en place des mesures de protection avancées pour prévenir les attaques sur les infrastructures (actes malveillant, cyberattaques…);
7- Disposer des équipes spécialisées pour gérer tout type d’incident sur les infrastructures critiques et vitales, coordonner les enquêtes et prendre des mesures correctives ;
8- Élaborer des plans détaillés de gestion d’urgence et de crise pour répondre efficacement aux menaces et aux incidents touchants chacune des infrastructures identifiées ;
9- Établir des partenariats et coopérer avec toutes les parties impliquées (services de renseignement, organismes de sécurité, secteur privé, …) afin de partager des informations et des bonnes pratiques en vue de coordonner les actions de sécurisation des infrastructures vitales.
En appliquant ces démarches de manière proactive et en collaboration, le gouvernement Guinéen pourra renforcer la résilience de ses infrastructures critiques, garantissant ainsi la sécurité de ses citoyens, de son économie et de sa souveraineté nationale. Cette approche aidera également à rétablir la confiance des citoyens envers les institutions du pays, ce qui est crucial pour assurer la sécurité, la sûreté et le bien-être de tous les Guinéens.
Mohamed Kourou Cissé
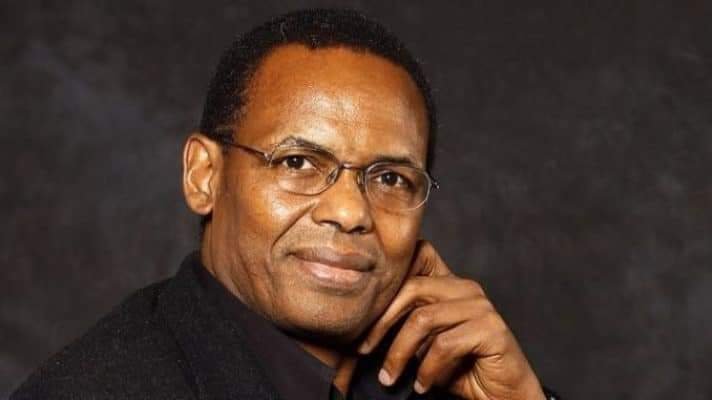

 Tribuneil y a 3 ans
Tribuneil y a 3 ans
 Politiqueil y a 4 ans
Politiqueil y a 4 ans
 Newsil y a 3 ans
Newsil y a 3 ans
 Newsil y a 3 ans
Newsil y a 3 ans
 Newsil y a 3 ans
Newsil y a 3 ans
 Newsil y a 3 ans
Newsil y a 3 ans
 Tribuneil y a 4 ans
Tribuneil y a 4 ans
 Justiceil y a 3 ans
Justiceil y a 3 ans

















